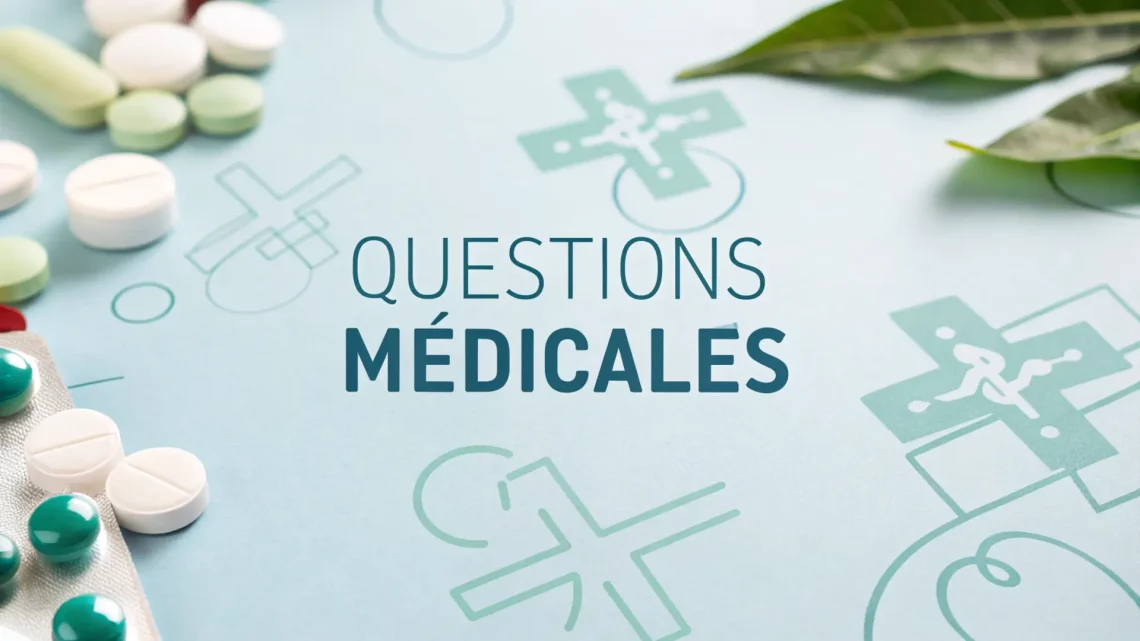
Maladie rénale : Les conséquences du diabète
La diabète peut entraîner de nombreuses complications, parmi lesquelles des lésions rénales, qui touchent une part significative des patients. La néphropathie diabétique, comme on appelle cette atteinte rénale, se développe progressivement et est liée à la maladie des glomérules rénaux, c’est-à-dire les petits vaisseaux sanguins impliqués dans le filtrage de l’urine. Au cours du processus, le tissu conjonctif entre les capillaires augmente, ce qui entrave le fonctionnement normal des reins.
La néphropathie diabétique est initialement asymptomatique, de sorte que beaucoup de personnes n’ont même pas conscience que leur fonction rénale est en déclin. Cependant, à mesure que la maladie progresse, la structure des reins change et la diminution des fonctions devient de plus en plus évidente. L’obésité, en particulier un indice de masse corporelle (IMC) élevé, est étroitement liée à l’augmentation du risque de lésions rénales. Heureusement, si le problème est détecté à temps et que des traitements médicaux appropriés, ainsi qu’un changement de mode de vie, sont mis en place, la progression de la maladie peut être ralentie, voire arrêtée.
La gravité de la néphropathie diabétique est classée en différents stades, ce qui permet de suivre l’évolution de la maladie.
Les stades de la néphropathie diabétique
La néphropathie diabétique peut être divisée en cinq stades différents, dont les deux premiers ne présentent pas de symptômes cliniques. Il est donc particulièrement important de réaliser des examens de dépistage réguliers, qui permettent de détecter les lésions rénales à un stade précoce.
Au premier stade, le rein grossit et la quantité d’urine filtrée augmente, mais il n’y a pas encore de plaintes. Au deuxième stade, la structure du rein est déjà altérée, mais le patient ne perçoit toujours pas de signes cliniques. Au troisième stade, une légère hypertension peut apparaître et des protéines peuvent être détectées dans l’urine, ce qui peut être un signe d’alerte.
Le quatrième stade se caractérise par une diminution significative de la fonction rénale. Le patient se sent fatigué, se plaint d’un malaise général et une perte de poids peut survenir. La structure rénale est déjà gravement endommagée, et la pression artérielle peut être anormalement élevée. Au cinquième stade, les lésions rénales sont si graves qu’une maladie rénale terminale se développe, accompagnée d’anémie, de nausées et de symptômes neurologiques.
La connaissance des différents stades de la néphropathie peut aider les patients et les médecins à choisir le traitement approprié et à suivre l’évolution de la maladie.
Comment diagnostiquer la néphropathie diabétique ?
Le premier signe de la néphropathie diabétique est la microalbuminurie, qui se manifeste par une petite quantité de protéines dans l’urine. Pour établir le diagnostic, un examen de laboratoire est nécessaire, au cours duquel la quantité de protéines excrétées est déterminée à partir d’urine collectée sur 24 heures. La valeur normale est inférieure à 30 mg/jour. Si la valeur se situe entre 30 et 300 mg/jour, cela est considéré comme pathologique et des examens supplémentaires sont nécessaires.
En outre, la fonction rénale doit également être surveillée en déterminant le taux de filtration glomérulaire (TFG), qui indique la capacité de désintoxication des reins. La valeur normale du TFG se situe entre 90 et 120 ml/min, et plus la valeur est basse, plus les lésions rénales sont graves. Des niveaux élevés d’activité de prorenine dans les analyses sanguines peuvent également indiquer un risque accru de développement de néphropathie.
Le contrôle de la glycémie joue un rôle clé dans la prévention de la néphropathie diabétique. La mesure du taux d’HbA1c aide les médecins à suivre l’efficacité du traitement du diabète. Atteindre une valeur de 7 % ou moins peut réduire considérablement le risque de néphropathie, qui est autrement de 40 % chez les diabétiques.
Comment traiter la néphropathie diabétique ?
Le traitement de la néphropathie diabétique est un processus complexe qui implique un contrôle strict de la glycémie. Le taux de glycémie idéal avant les repas doit être inférieur à 6,5 mmol/l, tandis que le taux après les repas ne doit pas dépasser 9 mmol/l. Maintenir un taux d’HbA1c autour de 7 % aide à ralentir la progression de la maladie.
Lors du traitement médicamenteux, il est important de considérer l’utilisation des inhibiteurs SGLT-2, qui non seulement réduisent la glycémie, mais ont également des effets bénéfiques sur le poids corporel et la pression artérielle. Les antihypertenseurs, en particulier les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE), peuvent également aider à réduire l’excrétion de protéines, tandis que les antagonistes de l’aldostérone peuvent également être efficaces.
Les traitements hypolipémiants, tels que les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, jouent également un rôle important dans la protection des reins, car ils empêchent l’aggravation de la néphropathie. De plus, un régime pauvre en sel, une activité physique régulière, ainsi que l’abandon du tabac et de la consommation d’alcool sont essentiels dans le traitement de la maladie.
Si la néphropathie est déjà établie, les besoins en insuline des patients peuvent diminuer, nécessitant ainsi des ajustements des doses. Dans le cadre des soins médicaux, il est important qu’un néphrologue participe également au traitement aux côtés du diabétologue. En cas de maladie rénale terminale, une dialyse ou une transplantation rénale peut devenir nécessaire, rendant ainsi la détection et le traitement précoces vitaux.

